Méditons l’Evangile d’aujourd’hui, temps du Carême – 4ème semaine, année B
Texte de l’Évangile (Jn 4,43-54)
Jésus, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu’un prophète n’est pas honoré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée; les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu’il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu’ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin.
Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver; il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: «Vous ne pourrez donc pas croire à moins d’avoir vu des signes et des prodiges?». Le fonctionnaire royal lui dit: «Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure!». Jésus lui répond: «Va, ton fils est vivant».
L’homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu’il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s’était trouvé mieux. Ils lui dirent: «C’est hier, au début de l’après-midi, que la fièvre l’a quitté». Le père se rendit compte que c’était justement l’heure où Jésus lui avait dit: «Ton fils est vivant». Alors il crut, avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu’il revint de Judée en Galilée.
«Jésus, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée»
Aujourd’hui nous rencontrons de nouveau Jésus à Cana de Galilée, où il avait réalisé le fameux miracle de la conversion de l’eau en vin. Et voici qu’il fait un nouveau miracle: la guérison du fils d’un fonctionnaire royal. Le premier avait été spectaculaire, mais celui-ci a sans doute plus de valeur: il ne résout pas un embarras matériel, il s’agit d’une vie humaine.
Ce qui attire l’attention ici, c’est que Jésus agit à distance. Il ne se rend pas à Capharnaüm pour guérir directement le malade; il lui redonne la santé sans bouger de Cana: «Le fonctionnaire royal lui dit: ‘Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure!’. Jésus lui répond: ‘Va, ton fils est vivant’» (Jn 4,49.50).
Cela nous rappelle que, tous, nous pouvons faire beaucoup de bien à distance, sans devoir être présents à l’endroit où l’on sollicite notre générosité. Nous aidons, par exemple, le Tiers Monde en collaborant économiquement avec nos missionnaires ou avec des entités catholiques qui y travaillent. Nous aidons les pauvres des quartiers marginaux des grandes villes par nos apports à des institutions comme Caritas, sans que nous devions y mettre les pieds. Nous pouvons même donner une grande joie à beaucoup de gens qui sont loin de nous, par un appel téléphonique, une lettre ou un message électronique.
Bien souvent, nous trouvons une excuse dans l’impossibilité d’être physiquement présents dans les lieux où il y a des nécessités urgentes. Jésus, n’a pas cherché d’excuse; il a fait le miracle.
La distance n’est pas un problème à l’heure d’être généreux, car la générosité sort du cœur et dépasse les frontières. Comme le disait saint Augustin: «Qui possède la charité dans son cœur, trouve toujours une chose à donner».
Abbé Ramon Octavi SÁNCHEZ i Valero (Viladecans, Barcelona, Espagne)
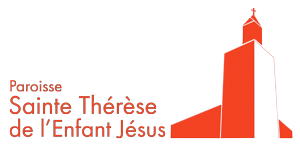






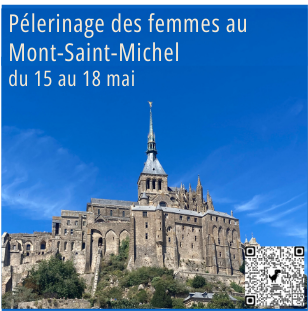
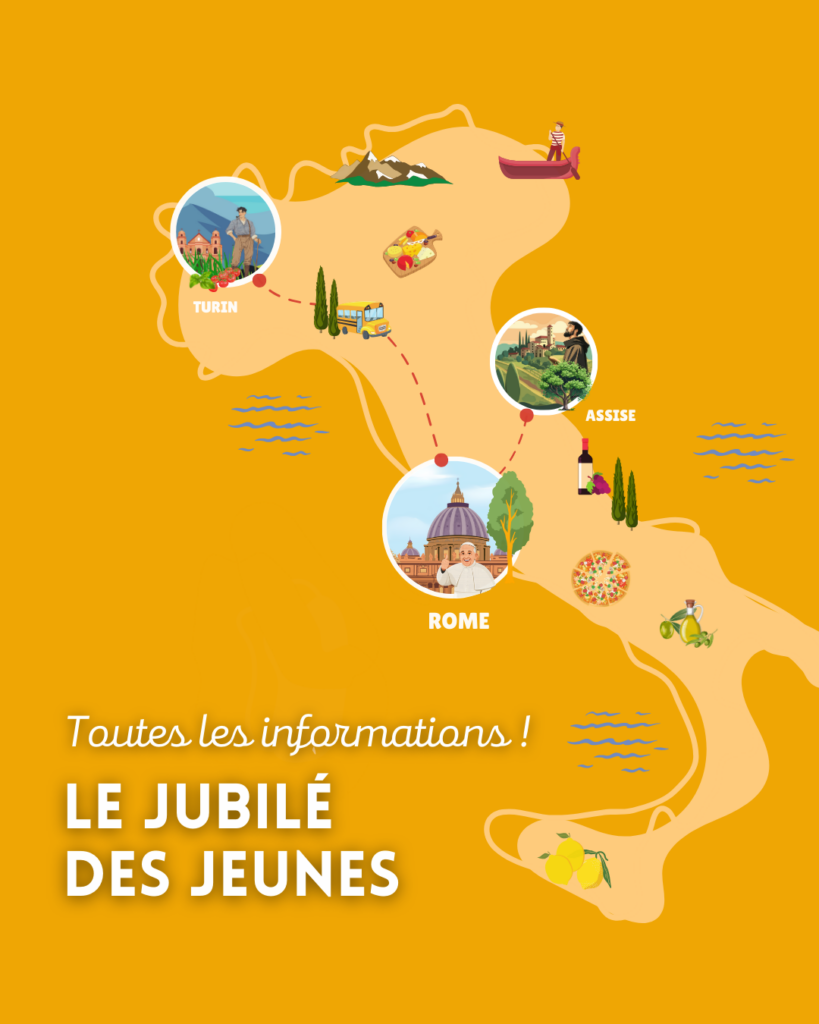










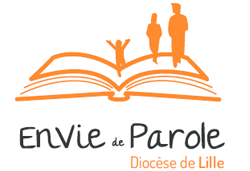
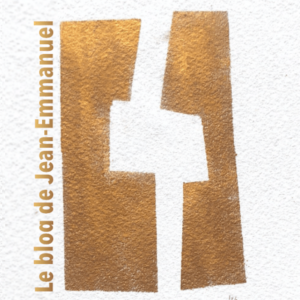



Lundi 15 mars : «Jésus, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée»
NouvellesMéditons l’Evangile d’aujourd’hui, temps du Carême – 4ème semaine, année B
Texte de l’Évangile (Jn 4,43-54)
Jésus, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu’un prophète n’est pas honoré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée; les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu’il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu’ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin.
Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver; il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: «Vous ne pourrez donc pas croire à moins d’avoir vu des signes et des prodiges?». Le fonctionnaire royal lui dit: «Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure!». Jésus lui répond: «Va, ton fils est vivant».
L’homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu’il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s’était trouvé mieux. Ils lui dirent: «C’est hier, au début de l’après-midi, que la fièvre l’a quitté». Le père se rendit compte que c’était justement l’heure où Jésus lui avait dit: «Ton fils est vivant». Alors il crut, avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu’il revint de Judée en Galilée.
«Jésus, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée»
Aujourd’hui nous rencontrons de nouveau Jésus à Cana de Galilée, où il avait réalisé le fameux miracle de la conversion de l’eau en vin. Et voici qu’il fait un nouveau miracle: la guérison du fils d’un fonctionnaire royal. Le premier avait été spectaculaire, mais celui-ci a sans doute plus de valeur: il ne résout pas un embarras matériel, il s’agit d’une vie humaine.
Ce qui attire l’attention ici, c’est que Jésus agit à distance. Il ne se rend pas à Capharnaüm pour guérir directement le malade; il lui redonne la santé sans bouger de Cana: «Le fonctionnaire royal lui dit: ‘Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure!’. Jésus lui répond: ‘Va, ton fils est vivant’» (Jn 4,49.50).
Cela nous rappelle que, tous, nous pouvons faire beaucoup de bien à distance, sans devoir être présents à l’endroit où l’on sollicite notre générosité. Nous aidons, par exemple, le Tiers Monde en collaborant économiquement avec nos missionnaires ou avec des entités catholiques qui y travaillent. Nous aidons les pauvres des quartiers marginaux des grandes villes par nos apports à des institutions comme Caritas, sans que nous devions y mettre les pieds. Nous pouvons même donner une grande joie à beaucoup de gens qui sont loin de nous, par un appel téléphonique, une lettre ou un message électronique.
Bien souvent, nous trouvons une excuse dans l’impossibilité d’être physiquement présents dans les lieux où il y a des nécessités urgentes. Jésus, n’a pas cherché d’excuse; il a fait le miracle.
La distance n’est pas un problème à l’heure d’être généreux, car la générosité sort du cœur et dépasse les frontières. Comme le disait saint Augustin: «Qui possède la charité dans son cœur, trouve toujours une chose à donner».
Abbé Ramon Octavi SÁNCHEZ i Valero (Viladecans, Barcelona, Espagne)
Dimanche 14 mars : «Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique»
NouvellesMéditons l’Evangile d’aujourd’hui, temps du Carême – 4ème dimanche, année B
Texte de l’Évangile (Jn 3,14-21)
Jésus dit à Nicodème: «De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique: ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en Lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.»
Et le Jugement, le voici: quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière: il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu».
«Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique»
Aujourd’hui la liturgie nous offre à l’avance un parfum de la joie pascale. Les vêtements liturgiques sont roses. C’est le dimanche de « lætare » qui nous invite à une joie paisible. «Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l’aimez…», crie le chant d’ouverture.
Dieu veut que nous soyons heureux. La psychologie la plus basique nous dit qu’une personne qui n’est pas heureuse finit par être un malade du corps et de l’esprit. Cela dit, notre joie doit être une joie qui a des bonnes bases, elle doit être l’expression de la paix d’une vie qui a un sens. Sinon, la joie dégénèrerait et deviendrait superficielle et stupide. Sainte Thérèse les distinguait avec justesse entre « sainte joie » et « folle joie ». La dernière étant une joie extérieure qui ne dure que très peu et qui nous laisse un goût amer.
Ce sont des jours difficiles pour la vie de la foi. Mais ce sont des temps passionnants également. Nous expérimentons, d’une certaine manière, l’exil de Babylone, celui que chante le psaume. Nous pouvons nous aussi vivre une expérience d’exil «nous pleurions, en nous souvenant de Sion» (Ps 136,1). Les difficultés extérieures, et surtout, le péché, peuvent nous amener sur les rivages de Babylone. Mais malgré tout, il y a des raisons pour garder l’espérance, et Dieu continue à nous dire: «Que ma langue s’attache à mon palais, si je cesse de penser à toi» (Ps 136,6).
Nous pouvons vivre toujours heureux car Dieu nous aime à la folie, tellement «qu’il a donné son Fils unique» (Jn 3,16). Bientôt, nous accompagnerons ce Fils unique dans son chemin de mort et résurrection. Nous contemplerons l’amour de Celui qui nous aime jusqu’au point de se donner pour nous tous, pour toi et pour moi. Et nous serons remplis d’amour en voyant «Celui qu’ils ont transpercé» (Jn 19,37) et grandira en nous une joie que personne ne pourra nous enlever.
La vraie joie qui remplit notre vie n’est pas le résultat de nos efforts personnels. Saint Paul nous le rappelle: elle ne vient pas de nous, c’est un don de Dieu, nous sommes son œuvre (Col 1,11). Laissons Dieu nous aimer et aimons-le en retour, et notre joie sera grande tant dans notre vie que lors de la prochaine Pâque. N’oublions pas de nous laisser caresser et transformer par Dieu en faisant une bonne confession avant Pâques.
Abbé Joan Ant. MATEO i García (Tremp, Lleida, Espagne)
Samedi 13 mars : «C’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste»
NouvellesMéditons l’Evangile d’aujourd’hui, temps du Carême – 3ème semaine
Texte de l’Évangile (Lc 18,9-14)
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient tous les autres: «Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même: ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes: voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne’. Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: ‘Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis!’. Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l’autre. Qui s’élève sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé».
«C’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste»
Fr. Gavan JENNINGS(Dublín, Irlande)Aujourd’hui, le Christ nous présente deux hommes qui, pour un observateur « ordinaire » pourraient sembler presque identiques, car ils se trouvent au même endroit et font la même chose: tous les deux sont «montés au temple pour prier» (Lc 18,10). Mais au-delà des apparences, au plus profond de leur conscience personnelle, les deux hommes diffèrent radicalement: l’un, le pharisien, a la conscience tranquille, alors que l’autre, le publicain —collecteur d’impôts— est inquiet car il ressent de la culpabilité.
Aujourd’hui, nous avons tendance à considérer les sentiments de culpabilité —le remords— comme quelque chose qui se rapproche d’une aberration psychologique. Cependant, le sentiment de culpabilité permet au publicain de ressortir du Temple réconforté, car «lorsque cet homme est redescendu à sa maison il était devenu juste alors que l’autre non» (Lc 18,14). «Ce sentiment de culpabilité» a écrit Benoît XVI quand il était encore le Cardinal Ratzinger (« Conscience et vérité ») «trouble la fausse tranquillité de la conscience et on peut l’appeler « protestation de la conscience » contre mon existence faite d’auto-satisfaction. Il est aussi nécessaire pour l’homme que la douleur physique, qui signifie une altération du fonctionnement normal du corps».
Jésus ne nous incite pas à penser que le pharisien ne dit pas la vérité quand il affirme qu’il n’est pas un rapace, qu’il n’est ni injuste ni adultère et qu’il jeûne et donne de l’argent au Temple (cf. Lc 18,11); ni que le collecteur d’impôts délire en se considérant comme un pécheur. Ce n’est pas la question. C’est plutôt que «le pharisien ne se rend plus compte que lui aussi est coupable. Sa conscience est complètement nette. Mais le « silence de la conscience » le rend impénétrable vis-à-vis de Dieu et des hommes, alors que le « cri de la conscience » qui inquiète le publicain le rend capable de sentiments de vérité et d’amour. Jésus peut troubler les pécheurs!» (Benoît XVI).
Fr. Gavan JENNINGS (Dublín, Irlande)